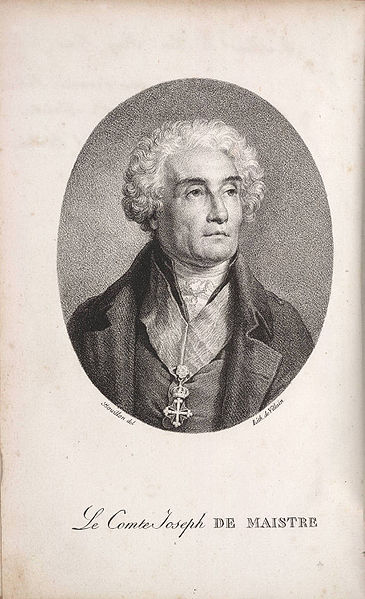IV
RÉSOLUTIONS A PRENDRE AU SUJET DE LA RELIGION
 |
| Allégorie de la Foi |
 ue toutes ces considérations et les preuves sans nombre qui combattent en faveur du Christianisme et de notre Église en particulier, vous invitent à répéter ces paroles et à dire résolument :
ue toutes ces considérations et les preuves sans nombre qui combattent en faveur du Christianisme et de notre Église en particulier, vous invitent à répéter ces paroles et à dire résolument :— Je veux demeurer insensible à tous ces arguments spécieux et si peu concluants, dont on se sert pour attaquer ma religion. Il n'est pas vrai, je le vois, qu'elle s'oppose aux lumières ; il n'est pas vrai, je le vois encore, que, bonne pour les époques barbares, elle ait cessé de l'être pour nous, puisque, après avoir suffi à la civilisation asiatique, à la civilisation grecque, à la civilisation romaine, aux gouvernements les plus divers du Moyen-Âge, elle a suffi en outre à tous les peuples qui après le Moyen-Âge ont commencé une civilisation nouvelle, et qu'aujourd'hui elle suffit encore à des intelligences qui, en élévation, ne le cèdent à aucune.
Depuis les premiers hérésiarques jusqu'à l'école de Voltaire et des siens, jusqu'à celle des relativistes de nos jours, tous les incrédules se sont vantés d'enseigner quelque chose de meilleur, et que jamais aucun ne l'a pu. Il n'est pas sans utilité de citer ici les exemples du communisme, du socialisme, du capitalisme ou encore du nazisme, tous ensemble engeance multiforme abominable d'un siècle détourné de Dieu. Donc ?
— Donc, tant que je me ferai gloire d'être l'ennemi de la barbarie et le zélateur des lumières, je me ferai gloire aussi d'être catholique, et je plaindrai ceux qui se moquent de moi, ceux qui affectent de me confondre avec les superstitieux et les pharisiens.
Ceci arrêté, et cette résolution prise, soyez ferme et persévérant ; honorez la religion de tout votre pouvoir par vos sentiments et par votre intelligence, et sachez également la professer parmi les croyants et les incrédules. Mais professez-la sans croire qu'il suffit d'accomplir froidement et matériellement les pratiques du culte ; il faut encore animer de nobles pensées l'observance de ces pratiques, y mettre tout votre cœur, vous élever jusqu'à la contemplation de la sublimité des mystères, sans prétendre orgueilleusement les expliquer ; vous pénétrer enfin des vertus qui en découlent, et n'oubliez jamais qu'adorer seulement par la prière ne suffit pas, si nous ne nous proposons d'adorer Dieu dans toutes nos actions, même les plus petites et les plus triviales. Repoussez dans le même temps loin de vous cette idée du siècle que la religion serait une affaire purement privée ; c'est par toute notre vie qu'il convient de glorifier Dieu.
« Écoute, Israël: le Seigneur, notre Dieu, est seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dt VI, 4-5
« Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu demande de toi, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu l'aimes, que tu serves le Seigneur ton Dieu en tout ton cœur et en toute ton âme » Dt X, 12.
« "Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi? " Il lui dit : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement ." » Mt XXII, 36-38
Il en est aux yeux de qui brillent de tout leur éclat la beauté et la vérité de la foi catholique ; ceux-là sentent qu'il n'existe aucune philosophie qui soit plus philosophique, plus qu'elle ennemie de toute injustice, plus qu'elle amie de tout ce qui tourne au profit de l'homme ; et cependant ils se laissent tristement aller au courant, ils vivent comme si le Christianisme était l'affaire du peuple, ou de l'homme privé, comme si les esprits cultivés et les hommes publics n'avaient que faire de lui. Ceux-là sont plus coupables que les véritables incrédules, et le nombre en est grand. Ayez en horreur cette tiédeur, cette avachissement qui fait rougir de l'Évangile devant les hommes ; soyez au contraire prêt à chaque instant à verser tout le sang de vos veines pour la Vérité.
« Celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Mc VIII, 38.
Que les railleries du monde vous trouvent insensible dès qu'il s'agira de confesser un sentiment noble ; et de tous le plus noble, c'est d'aimer Dieu.
Si vous passez des fausses doctrines ou de l'indifférence à la profession sincère de la foi catholique, n'allez pas non plus donner aux incrédules le scandaleux spectacle d'une ridicule bigoterie et de scrupules pusillanimes ; soyez humble devant Dieu et devant les hommes, mais sans jamais oublier votre dignité d'homme ni abdiquer la saine raison. Il n'y a de raison contraire à l'Évangile que celle qui se complait dans l'orgueil et la haine.
« Mais l'heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Jn IV, 23-24